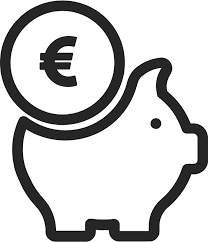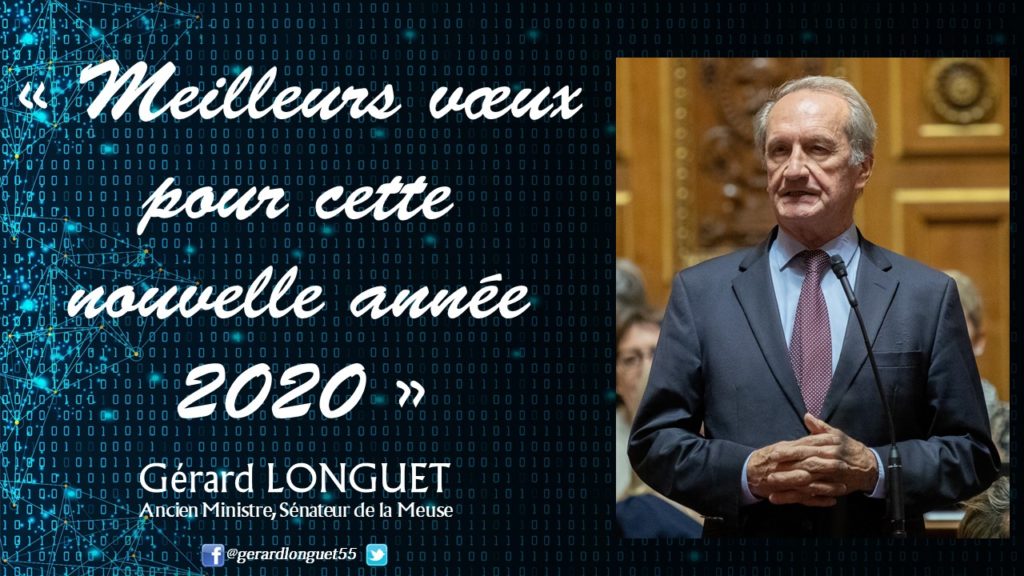Ma réaction à la suite du dépôt, par le Groupe LIOT, d’un texte visant à supprimer la réforme des retraites
Concernant le débat du 8 juin prochain, consacré à la PPL du Groupe LIOT qui se propose de revenir à 62 ans pour l’âge de plein exercice de la retraite, je désapprouve la forme et le fond.
La forme tout d’abord : qui peut croire qu’avec quelques heures de débat, on puisse régler sérieusement un tel problème, surtout en faisant appel de nouveau à une dépense publique que tous jugent déjà excessive ? C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Constitution de 1958, approuvée à plus de 85% des Français et jamais démentie depuis, comporte le principe de l’Article 40 selon lequel les Députés ne peuvent voter une dépense que s’ils sont certains d’en assurer le financement. Sinon, tout serait facile, « demain on raserait gratis, tout le temps et pour tout le monde ». Les vociférations de NUPES n’y peuvent rien. Il n’est pas digne de s’y associer.
Sur le fond, on ne peut pas s’arrêter de travailler plus tôt que les autres pays européens, accumuler les déficits et, sans fin, emprunter la différence. C’est pourtant le cas de la France. Certes, tous les Gouvernements depuis 1981 ont leur part de responsabilité. Depuis 2017, l’inspecteur des Finances, Emmanuel MACRON, autant que les autres, des « Gilets jaunes » qu’il fallait apaiser au « quoi qu’il en coûte » à plus de 100 milliards d’Euros, en passant par les sympathiques baisses d’impôts qui ne correspondent cependant à aucune baisse des dépenses, tout se paye en endettant les contribuables.
Aujourd’hui, l’éclairage porte sur les retraites par répartition, un système où les actifs payent pour les retraités. En d’autres termes, un système où les « jeunes » payent pour les « vieux ». Ce système, au plan national, verse 345 milliards d’Euros aux retraités dont la situation s’est bien améliorée pour beaucoup d’entre eux depuis 40 ans. Hélas, chaque année, il y a moins de jeunes et plus de vieux, premier problème.
Second problème, ce système ne repose que sur 250 milliards d’Euros de cotisations. La différence ce sont les impôts d’État qui les payent. D’abord en aidant les régimes en déficit lourd : l’agriculture, par exemple, car il y a plus de retraités que d’actifs dans ce système particulier. Les régimes dits « spéciaux » (transport et énergie) vont petit à petit s’aligner, mais dans 30 ou 40 ans. Le régime de la Fonction Publique d’État qui est équilibré certes, mais parce que l’État – c’est-à-dire nous les contribuables – verse des cotisations très supérieures au régime général.
Ces charges – plus de 40 milliards d’Euros – privent l’État de sa capacité à intervenir en faveur de l’Enseignement, de l’Hôpital, de la Recherche et de la Sécurité. L’État doit donc, lui aussi, faire des efforts.
Travailler un peu plus longtemps, comme nos voisins européens, est la première étape d’une reprise de confiance, celle qui permet d’espérer d’affronter tous nos problèmes.
Si nous ne le faisons pas maintenant – et déjà avec 30 ou 40 ans de retard sur nos voisins – la réponse sera simple : ce qui est collectif, en France, ne fonctionnera plus et chacun essaiera de s’en sortir tout seul. L’Éducation, la Santé, la Sécurité et naturellement les retraites obéiront à la règle du chacun pour soi, « selon ses revenus ». Le contraire de ce que veulent la majorité des Français, moi le premier.
Chacun sait que j’ai soutenu Bertrand PANCHER, Député de la Meuse, à toutes les élections où il a été candidat. C’est pourquoi je lui dis que s’il veut faire capoter la réforme des retraites, qu’il nous dise d’abord pour faire quoi ? Augmenter les impôts ? Baisser les retraites ? Ouvrir, de fait, une capitalisation qui se substituera à la solidarité actuelle ? Et avec qui ? La NUPES ? Le RN ? Renforcés par quelques dissidents LR égarés entre le rejet d’Emmanuel MACRON et la soif de notoriété personnelle ? Lors de la dernière campagne présidentielle en 2022, le candidat Emmanuel MACRON avait, enfin, joué carte sur table, annonçant même un report à 65 ans ! Tous les Français étaient prévenus !
Notre Député prend deux risques : être en porte-à-faux de ce qu’il a toujours défendu par le passé, ou bien ouvrir – s’il rassemble une coalition hétéroclite – la porte à ceux qu’il a toujours combattus, de François HOLLANDE à Marine LE PEN. En tous cas, ce sera sans le Sénat et sans moi, pourtant son partenaire et son ami depuis si longtemps.
Gérard LONGUET